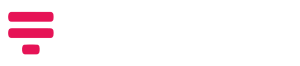
Ça faisait un moment qu’on le pressentait et il n’aura pas fallu plus de trois étés. Après la publication sur le site du ministère de la Culture du Mémento sur les ensembles démontables du Synpase en juillet 2020, après la disparition nette des recommandations du conseil national de la scénographie sur le doublement des coefficients de sécurité durant l’été 2021, sous la pression continue depuis au moins 2018 des fabricants de machinerie scénique pour que la réglementation ERP française s’harmonise avec la norme BGV-D8 allemande, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont entériné cette lame de fond par la publication de l’Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables
Cet arrêté qui regroupe en un seul texte de nombreuses réglementations déjà existantes semble avoir eu pour objectif de synthétiser les bonnes pratiques lors de l’organisation d’évènements à un moment où leurs fréquences comme leurs fréquentations allaient être particulièrement élevées. Toutefois, il a suscité de nombreuses interrogations, notamment dans le secteur du spectacle vivant en salle, pour lequel certaines dispositions sont difficilement applicables en l’état.
Un cadre général aux exigences tous azimuts
L’arrêté du 25 juillet 2022 repose sur plusieurs piliers :
- Un champ d’application large : l’arrêté touche à la fois aux questions de conception et de montage de scènes, gradins, échafaudages ou grils, mais aussi de levage, de sécurité incendie ou d’organisation d’événements (électricité, évacuation, dossier de sécurité…)
- Des exigences techniques : calculs de stabilité, marquage des pièces constituant les ensembles, vérifications périodiques…
- Des contrôles augmentés : recours plus nombreux à des organismes de contrôle agréés, attestation de bon montage, inspections régulières…
- Une documentation détaillée : plans, notices de sécurité, cahier des charges, dossier de sécurité…
Ces exigences, qui sont une piqûre de rappel aux prestataires événementiels et qui sécurisent les organisateurs occasionnels d’événements peu au fait de leurs obligations, ne prennent pas toujours en compte les spécificités techniques et organisationnelles du spectacle vivant traditionnel, notamment dans les établissements recevant du public de type L.
Des particularités du spectacle vivant à mieux prendre en compte
Depuis la publication de l’arrêté, de nombreux professionnels du spectacle vivant ont exprimé leurs préoccupations. En cause : l’absence de distinction claire entre les structures temporairement montées pour un événement ponctuel dans un lieu peu spécifique et les lieux à la fois conçus pour recevoir des ensembles démontables dans le cadre d’un usage récurrent (théâtres, opéras, auditorium…) mais aussi disposant de professionnels techniques dont l’étude de faisabilité, le montage et l’exploitation sont le cœur de métier.
L’association Réditec, qui rassemble des responsables techniques du secteur, a engagé dès 2023 un travail d’analyse des difficultés concrètes rencontrées sur le terrain. Plusieurs points d’attention ont été identifiés :
⇒ Des décors uniques et conçus sur mesure : les éléments fabriqués pour un spectacle spécifique qu’ils soient mécano-soudés ou adaptés sur de la structure préfabriquée (ponts, praticables, etc..) ne peuvent être assimilés à des structures démontables telles que décrites et pensées dans l’arrêté. Car, comme l’ont rappelé de nombreux professionnels au sein de Réditec ces décors sont :
- dessinés spécifiquement pour une œuvre ou une mise en scène ;
- validés par un bureau d’études et, si nécessaire, par un ingénieur structure ;
- construits dans des ateliers spécialisés, souvent sous supervision directe ;
- montés et exploités par les mêmes équipes techniques pendant toute la tournée. Équipes elles-mêmes formées et compétentes.
- installés majoritairement à l’intérieur de cages de scène conçues et destinées à recevoir des décors sans mettre en danger le public.
Ils relèvent donc d’une logique d’ingénierie du prototype et d’une méthode d’installation bien éloignée des structures événementielles standardisées visées par l’arrêté. Les contrôleurs des organismes agréés restent d’ailleurs bien souvent démunis face à des structures qui ne répondent à aucun référentiel.
⇒ Une remise en question des fondamentaux métiers. Depuis plusieurs années déjà les métiers de régisseur. se. s plateau et machinistes se sont hautement professionnalisés, l’existence de formations initiales et continues depuis les années 2000 associées à un savoir-faire artisanal traditionnel fait que, dans les maisons de théâtre, les équipes plateau sont maîtres de leur gril. La conception même des cages de scène permet à la fois un usage standard et une grande souplesse. Nous pouvons ainsi équiper des points fixes, équiper des sous-perches, installer des moteurs partout ou presque au-dessus de la scène. Cette souplesse de la cage de scène nous donne la capacité de répondre à l’imagination de ceux et celle qui créent et au service de qui nous sommes. Faire passer un organisme agréé à chaque sous-perche appuyée au-delà de 6m 20 est donc perçu au mieux comme une aberration, au pire comme un réel mépris de nos métiers.
⇒ Une lecture compliquée de l’arrêté par les lieux de spectacle : l’intégration de questions de levage dans l’arrêté a beaucoup fait parler et nombreuses ont été les incompréhensions sur la place des équipements existants générant de nombreux débats et contrôles inutiles.
⇒ Une complexité accrue pour les tournées : les équipes en déplacement doivent souvent réadapter leur décor à chaque salle, dans des conditions prévues dès la construction. Le système d’« avis sur modèle » s’avère peu compatible avec cette logique, entraînant des démarches administratives lourdes.
⇒ Des arbitrages complexes pour les directeur. trice. s et régisseur.se.s : la coexistence de cet arrêté avec le cadre réglementaire existant et globalement maîtrisé par les cadres techniques, conduit parfois à des injonctions contradictoires d’où une incertitude sur le positionnement à adopter et des échanges parfois tendus entre compagnies et structures. C’était le cas du L57 qui a été modifié à posteriori, et c’est le cas par exemple de l’article 26 de l’arrêté avec l’article R 4323-35 du Code du travail.
⇒ Une paperasserie chronophage : c’est le cœur du métier de directeur ou directrice technique de faire une étude de faisabilité pour chaque spectacle lorsque les saisons se conçoivent. Prendre en compte l’ensemble des réglementations existantes, assurer la sécurité de ses équipes et du public sont leur préoccupation quotidienne. Constituer un dossier de sécurité de type événementiel pour chaque spectacle de la saison qui a un praticable, une sous-perche ou un bout de pont n’a aucune plus-value en termes de sécurité tout en augmentant considérablement la charge de travail.
Des tentatives individuelles et collectives et des rebondissements
Face aux difficultés soulevées, un arrêté modificatif publié en décembre 2023 était venu clarifier certains points, en excluant notamment les décors scéniques du champ de l’arrêté initial. Cette avancée — obtenue en partie grâce au travail argumenté de Réditec — bien qu’insuffisante avait été largement saluée.
En avril 2025, le Conseil d’État a annulé ce texte pour incompétence juridique, estimant que le ministère de l’Intérieur n’était pas habilité à édicter seul cette dérogation. Le texte de juillet, qui aurait dû subir le même sort puisque le ministère de l’Intérieur n’était pas plus habilité en 2022 qu’en 2025 à édicter ce texte, n’a malheureusement pas pu être annulé en raison du délai de recours qui est de 2 mois après la publication d’un décret. Le fond n’ayant pas été remis en cause, l’insécurité réglementaire reste d’actualité..
Une demande de concertation pour une réglementation adaptée
Face à cette situation, Réditec poursuit son travail d’analyse et de proposition. L’association, forte de l’expertise de ses membres sur le terrain, souhaite aujourd’hui contribuer activement à l’élaboration d’un cadre réglementaire plus équilibré, à la fois rigoureux sur le plan de la sécurité et compatible avec les réalités techniques du spectacle vivant.
Depuis 2023, Réditec a formulé plusieurs propositions d’ajustements, fondées sur des cas concrets rencontrés dans les établissements culturels. L’objectif est de permettre aux équipes de continuer à garantir la sécurité sans compromettre la créativité, la réactivité et la faisabilité des productions.
Une concertation plus étroite avec les pouvoirs publics permettrait de construire un cadre cohérent, plus lisible et respectueux des spécificités de chaque type d’équipement. La sécurité du public et des professionnels et professionnelles doit rester une priorité partagée, pensée de manière pragmatique et collaborative.
Par Vanessa Petit et Bérengère Naulot



