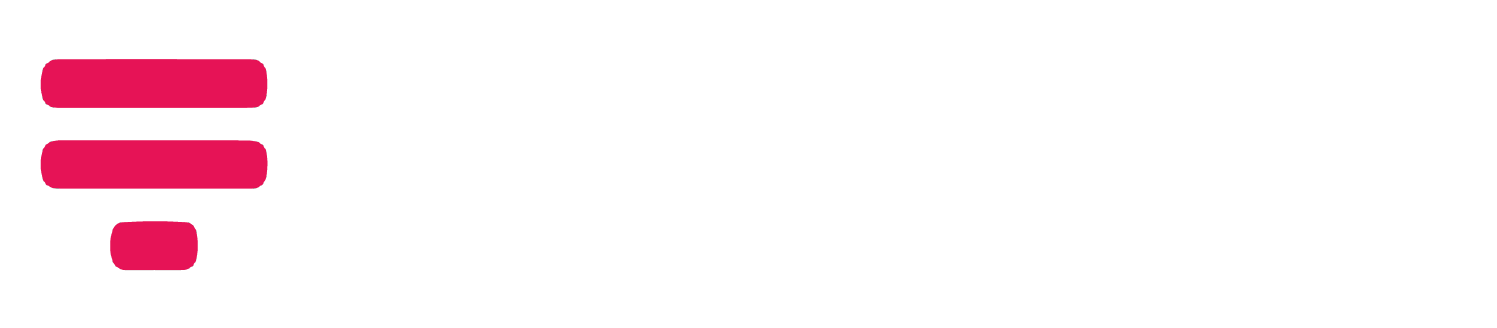
« Tant qu’il n’y a pas de problème commun, il n’y a pas de réseau !»
Un contexte international belliqueux, une concurrence intercontinentale ayant rarement atteint un tel niveau, un projet Européen qui se cherche toujours, des gouvernements successifs qui, à force de dénigrer les services de l’État, finissent par les rendre incapables d’adapter leurs modèles économiques à la réalité changeante, une défiance permanente d’une présidence de la République jouant avec le feu…. Et voilà quarante ans de politique culturelle française qui passent de vie à trépas. Les annonces, à force de se répéter, finissent par presque passer inaperçues pour l’opinion publique. Et pourtant, moins 10%, moins 50%, moins 70% ou suppression pure et simple des subventions des collectivités territoriales allouées au monde de la culture, la palette est large et les effets sont immédiats. Tandis que les syndicats de salariés dénoncent un plan massif de suppression de postes dans l’industrie manufacturière, un mouvement profond est à l’œuvre dans le secteur public de la culture et plus particulièrement dans celui du spectacle vivant. Les annulations de projets, les réductions de tournées, conduisent silencieusement à la disparition de l’emploi de nombreux artistes mais aussi de nombreuses techniciennes et techniciens du spectacle vivant. Concrètement personne ne sait encore mesurer l’ampleur du phénomène. Mais il est d’ampleur, c’est certain !
Quand on annonce une baisse de 54% des programmations (Cf. https://www.artcena.fr/fil-vie-pro/lapas-alerte-sur-la-situation-critique-du-spectacle-vivant-public), on peut s’attendre à des conséquences graves sur l’emploi des professionnels qui devaient assurer ces représentations.
Donc, moins d’emplois pour les professionnels en exercice mais aussi moins de formations pour préparer le renouvellement des générations. Cela veut dire des compétences qui disparaissent et des compétences qui ne s’adaptent pas aux nouveaux enjeux.
Pour les métiers techniques le coup, ou le coût, va être rude… mais pas tout de suite.
Quand les directions et les programmateurs sauront enfin avec quel budget travailler (car les votes des budgets par les instances régionales, départementales et municipales sont tous reportés et conditionnés au vote de celui de l’État) alors les techniciens commenceront seulement à en mesurer les conséquences.
Moitié moins d’activité, ce sont des équipements sous employés pour lesquels il sera difficile de motiver des travaux de maintenance ou d’amélioration, dégradant ainsi les conditions de travail. Mais ce sont aussi des équipes dont l’animation devient de plus en plus hasardeuse avec la disparition invisible des techniciens intermittents ne pouvant attendre une embellie et forcés de se recycler. La gestion de tous ces aléas occupera les responsables techniques et, avec les miettes de programmation qu’il faudra malgré tout assurer, il ne restera plus beaucoup de temps pour penser à l’avenir de nos métiers et à l’évolution des pratiques pour accompagner la transition écologique tant attendue.
Les montants de baisse de subvention sont éloquents et sont aujourd’hui principalement assumés par les collectivités territoriales. L’État, se réservant le beau rôle, arrive à faire porter la quasi-totalité de l’effort sur les territoires. C’était prévisible quand on sait que ces mêmes territoires sont, étaient, les premiers financeurs de la culture. Ce qui l’était moins en revanche, c’était d’imaginer que cette situation allait permettre à certaines dirigeantes et dirigeants politiques d’accélérer leur agendas en testant leurs idées les plus radicales. Avec, comme symbole suprême, le re-questionnement du principe même de politique publique de la culture. Or c’est malheureusement ce à quoi nous assistons dans déjà trop de territoires. Aussi, tout comme les climatologues craignant l’arrêt de la circulation méridienne de renversement de l’Atlantique (AMOC) à force de changement climatique, nous devons craindre la disparition de la politique publique du spectacle vivant qui, à force de ne plus pouvoir montrer les spectacles, ne pourra plus justifier l’entretien de son réseau de diffusion et des emplois associés, et notamment ceux des métiers techniques.
Aussi, en nous rappelant le rôle central que les responsables techniques ont su jouer au moment des différentes crises récentes (sécuritaires, sanitaires), il est temps de mobiliser nos ressources pour porter à la connaissance des citoyens notre analyse et faire en sorte que le débat s’engage sur la question de la politique culturelle du pays et sur la façon de la mener sur les territoires.
Les responsables techniques se sont organisés depuis 2006 en créant Réditec pour fédérer les initiatives réparties sur tout le territoire national afin de partager leurs expertises et d’attirer l’attention des pouvoirs publics. Aujourd’hui nous pouvons aussi nous appuyer sur des réseaux dynamiques organisés à l’échelle des régions pour relayer nos inquiétudes et négocier des solutions pour l’intérêt général.
Sur la région Nouvelle-Aquitaine, par exemple, le Réseau Néo-Aquitain des Responsables Techniques du spectacle vivant (RéNART) entretient des relations de proximité avec les différents niveaux de collectivités territoriales, ville, département, région mais aussi avec les instances de nos professions, AFDAS, CNFPT, France Travail, DRAC, Agence culturelle, OARA et avec les autres réseaux professionnels, directions de salles (R535) …
En articulant nos actions au niveau national et celles au niveau local notre profession a les moyens de se faire entendre et d’encourager le débat public. Encore faut-il que nous osions sortir de l’ombre.
Vincent Robert



